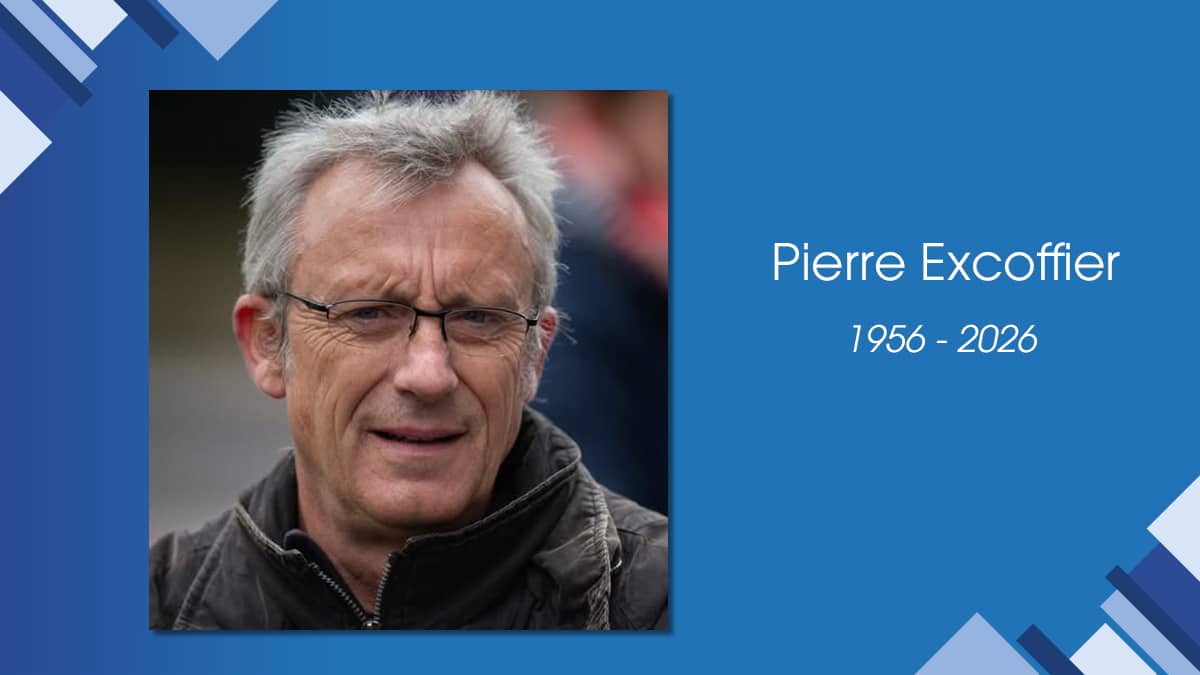ACTUALITÉS
La CST présente son nouveau bureau et un nouveau président d’honneur
Lors de l’assemblée générale en avril dernier, les membres de la CST ont élu la liste portée par André Labbouz, succédant à celle portée par Angelo Cosimano depuis juin 2022.
Le 3 juillet dernier, le nouveau Conseil d’administration de la CST a nommé son bureau pour l’année 2025/2026, ainsi constitué :
- Président : André LABBOUZ
- Vice-Présidente : Claudine NOUGARET – Productrice, réalisatrice et ingénieure du son
- Vice-Président : Jean-Baptiste HENNION – Directeur général JB Ciné
- Secrétaire : Ken LEGARGEANT – Exploitant de salles de cinéma et producteur
- Trésorier : Jean-Marie DURA – Senior Consultant, M&A & Cinema Specialist
- Consultante : Audrey BIRRIEN – Cheffe de projet, spécialisée dans la numérisation et la restauration de films et vidéos.
- Consultante : Chloé CAMBOURNAC – Cheffe décoratrice
- Consultante : Hélène DE ROUX – Formatrice fondatrice de Ciné-Système, réalisatrice et Sales & Marketing Support pour Zeiss Group
- Consultant : Gérard KRAWCZYK – Réalisateur et scénariste
- Consultante : Françoise NOYON – Directrice de la photographie
- Consultant : Bertrand SEITZ – Chef décorateur
Suite à l’élection du bureau, le Conseil d’administration a élevé Angelo Cosimano, président de la CST de 2018 à 2025, au rang de Président d’Honneur de la CST.
C’est avec beaucoup d’émotions que les proches d’Angelo Cosimano se sont réunis en juin dernier pour le remercier de son engagement envers l’association en tant que délégué général pendant 6 ans, puis en tant que président de la CST. Retrouvez ce moment émouvant.
Retrouvez l’entretien croisé entre Angelo Cosimano et André Labbouz publié dans la dernière Lettre de la CST.
D’un président à l’autre : entretien croisé entre Angelo Cosimano et André Labbouz.
Que se passe-t-il quand un ancien président de la CST et son successeur sont interviewés ensemble ? Pour marquer la passation entre Angelo Cosimano et André Labbouz nous avons voulu tenter l’expérience.
Comment êtes-vous arrivé à la CST ?
André Labbouz : Mon premier contact avec la CST date de l’ouverture de ma première salle à Caussade, dans le Tarn-et-Garonne. On m’avait dit qu’il fallait envoyer les plans via l’architecte à la CST, à un certain Michel Grapin. Ensuite, j’ai ouvert la salle de Gaillac, à la fin de l’année 1982, salle qui était aidée par l’ADRC. Tous les plans ont été envoyés également à la CST pour vérifier les dégagements des têtes, car c’était une salle unique qui allait se scinder en deux. Je n’ai pas tout de suite adhéré à la CST. Ce n’est qu’à partir de 1989 quand je suis devenu directeur technique de Gaumont que des gens du laboratoire Éclair m’ont conseillé de rejoindre l’association, ce que j’ai fait à titre personnel et non pour Gaumont. A l’époque j’avais intégré le département Laboratoire qui depuis est devenu le département Postproduction, j’ai même été représentant du département pendant un moment. A cette époque-là, seuls les membres élus assistaient au conseil d’administration mais pas les représentants. J’ai notamment partagé ce poste avec Patrick O’Rourke, directeur technique d’Éclair Laboratoire. J’ai connu plusieurs présidents : de Michel Fano (président de 1981 à 1985/NDR) à Jean-Pierre Neyrac (président de 1998 à 2000 puis de 2000 à 2001/NDR) en passant par René Fauvel (président de 1995 à 1998/NDR) que j’adorais et qui venait du groupe UGC. Finalement, des désaccords avec la direction (le président et le délégué général) m’ont poussé à quitter la CST au début des années 2000. J’y suis revenu vers 2006-2007, à la demande de Laurent Hébert et Pierre-William Glenn, même si j’étais en désaccord à cette époque, au point d’avoir participé à monter une liste contre Pierre-William Glenn lors des premières élections.
Angelo Cosimano : Pour ma part, j’ai dû entendre parler de la CST vers 1973, quand j’ai commencé en tant que projectionniste. Pour nous, depuis une cabine de projection en province, la CST représentait l’alpha et l’oméga de la technique : toutes les règles de projection provenaient d’elle. Vu de province, la CST était une sorte d’icône référentielle et quasi légale, au même titre que le CNC ; vu comme un organisme quasi-gouvernemental. Quelques années plus tard, à Paris, j’ai travaillé avec Gérard Lamps, qui est devenu le recordman du nombre de César (sept !) et dont j’étais l’assistant. Une des premières choses qu’il m’a dite, c’était : « Ne me parle pas de la CST, je ne veux pas parler de gens qui passent leur temps à pinailler ! » Je ne m’en suis pas occupé avant la fin des années 90, moment où la CST est revenue sur le devant de la scène du fait de l’essor du numérique. Elle était jusque-là très marquée « cinéma » et s’était désintéressée de la vidéo, alors que les évolutions technologiques de 1980 à 2000, étaient presque entièrement liées à la vidéo. C’est avec l’apparition du cinéma numérique comme nouvel horizon que j’ai réintégré la CST et que cela a pris tout son sens pour moi. Je suis donc arrivé à la CST en 2002 et j’ai été choisi comme délégué en 2013… Une anecdote intéressante dans la petite histoire de la CST : le fameux contrôle des salles, aujourd’hui perdu, était une idée proposée au CNC au début des années 70, lors de l’apparition des premiers complexes cinématographiques – qui consistait alors à transformer une grande salle en la divisant par trois sans se soucier vraiment du confort de projection pour les spectateurs. C’était un tel désordre que Michel Baptiste et Michel Grapin ont proposé aux responsables du CNC de l’époque, peut-être M. Kervio, de créer un règlement encadrant ces pratiques. Ce règlement incluait l’obligation de faire contrôler les projets architecturaux des salles par la CST.
A. L. : Effectivement, tous les exploitants envoyaient leurs plans à la CST, pas seulement les indépendants, mais aussi les grands groupes comme UGC, Pathé, Gaumont. Ces normes n’existaient pas avant ; elles ont été créées précisément pour administrer ce contrôle. Auparavant, chacun faisait ce qu’il voulait sans beaucoup de contrôle, le CNC ne supervisant que la billetterie. C’est d’ailleurs pour ça que la CST avait une image négative auprès des exploitants : on les obligeait à investir pour assurer la conformité de leurs salles.
A. C. : C’était l’époque où les complexes avec cinq salles étaient considérés comme très grands. Puis dix ans plus tard sont arrivés les multiplexes. Je me souviens d’avoir eu comme voisin de bureau chez Télétota, un ancien d’une major américaine, dont la légende voulait qu’il eût participé à la production de Trois hommes et un couffin de Coline Serreau. Il a travaillé deux ans sur un projet de multiplexe d’au moins dix salles. Tout le monde s’est moqué de lui et il a fini par abandonner. Ce projet a été repris par Kinépolis en 1995.
A. L. : Exact. Dans la foulée, Gaumont avait déjà commencé ses multiplexes. Jean-Louis Renoux, alors directeur de l’exploitation, a ouvert le premier à Calais en 1995. Ensuite, les multiplexes se sont multipliés dans toutes les zones industrielles et commerciales. En centre-ville, il y avait aussi des salles comme l’UGC Les Halles et l’Orient Express, qui comptaient respectivement six et quatre salles. Avant ça, il y avait le parc océanique Cousteau qui n’a jamais fonctionné et a été racheté par UGC.
Quand vous êtes-vous rencontrés pour la première fois ?
A. C. : André et moi nous connaissions bien avant la CST. André travaillait avec Éclair, et quand Éclair ne parvenait pas à réaliser certains projets vidéo, ils atterrissaient chez nous à Teletota. Notre première véritable discussion s’est produite à un congrès des exploitants vers 2000-2001. J’étais à sa table, celle des non-exploitants. André m’avait dit : « Jamais je ne travaillerai avec des étalonneurs de pubs. »
A. L. : Le cinéma, c’est le cinéma, ce n’est pas le même métier ! Plus tard, on s’est également croisés au laboratoire Telcipro.
A. C. : Oui, moi j’étais dans le bureau de Charlie Meunier, au moment de la fusion entre Télétota et Telcipro au sein du groupe Tectis, qui était né du rapprochement avec Eclair qui, à la fin des années 90, était en proie aux pires difficultés. L’entreprise comptait 600 employés, dont 300 que l’on pourrait qualifier d’héritage du passé. Le mode de gestion de l’époque consistait surtout à compenser l’inefficacité de certains par la création de postes supplémentaires. Après un plan de restructuration financé par la vente des studios de Boulogne, et en l’espace de deux mois, Éclair est redevenu rentable, passant de millions de francs de pertes à plusieurs millions de bénéfices. Ces profits leur ont permis d’emprunter pour financer le laboratoire de tirage qui, pendant 15 ans, a produit entre 150 et 200 millions de mètres de pellicule.
A. L. : C’était en 1990. Dans la foulée, ils ont construit le premier laboratoire écologique de 35 mm, et en quatre ans, la restructuration achevée a également permis, avec le concours de Gaumont de construire le stock d’Augy qui aujourd’hui stocke toujours 75 % du cinéma français…
Comment André a-t-il intégré les instances dirigeantes de la CST ?
A. L. : J’étais au conseil d’administration à ce moment-là, mais pas au bureau avec Willy (Pierre-William Glenn, président de la CST de 2002 à 2018/NDR). Donc voilà, on s’est retrouvés au sein du conseil de la CST dans les années 2000. J’ai donc participé au recrutement d’Angelo en tant que délégué général bien que je ne fasse pas encore partie du Bureau.
A. C. : Aux élections suivantes, j’ai demandé à Willy de mettre André sur sa liste. André était tout à fait légitime car il représentait le secteur de l’exploitation et que les listes se doivent de contenir des représentants de chaque secteur d’activité de l’industrie cinématographique. Contrairement à d’autres, André ne manquait jamais aucune réunion et faisait la jonction parfaite entre les salles de cinéma, la production et la postproduction. Après, c’était aussi une question de feeling.
A. L. : Quand Angelo me l’a proposé, j’ai tout de suite dit oui. Cela m’intéressait d’être plus actif. Il fallait quand même que je demande la permission à la direction de Gaumont qui a accepté à condition que cela n’empiète pas sur mon temps de travail pour eux, ce qui n’était pas le cas, car les réunions de bureau se déroulaient durant l’heure du déjeuner.
Avez-vous travaillé ensemble sur des dossiers importants à la CST ?
A. L. : Non, mais Angelo et moi nous appelions très régulièrement quand il était délégué général. Il me demandait souvent de venir en amont des conseils d’administration pour que nous discutions.
A. C. : A titre individuel, je suis très fier du travail que nous avons accompli sur la création du nouveau modèle de devis et qui a pris trois ans. Je suis parvenu à le faire adopter par le CNC avec une obligation de sécurisation numérique des œuvres qui est certes incomplète mais qui a le mérite d’exister.
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué, techniquement comme humainement durant vos années à la CST ?
A. C. : Hormis le numérique, il n’y a pas eu de gros bouleversements techniques. Le prochain grand bouleversement surviendra quand on trouvera un support de stockage physique pérenne pour les films. Je ne crois pas à une arrivée prochaine. Je dirais plutôt à horizon quinze ans, mais pour l’instant ce type d’innovation n’est pas dans l’intérêt des entreprises qui vendent des puces et des serveurs… Peu de gens ont à y gagner. Pour le reste, ce sera plus de l’ordre de l’amélioration de techniques déjà existantes comme des trucages que l’on pourra pré-intégrer dans des têtes de caméra, ce genre de choses… Cela changera un peu la technique, le temps d’acquisition de savoir-faire des techniciens sera de plus en plus court et donc peut-être de moins en moins efficient.
En ce qui concerne la CST, il faut qu’elle reste sur cette mission de préservation et valorisation des savoir-faire en imposant le fait qu’il doit toujours y avoir un contrôle humain sur la machine. L’espèce humaine arbitre très souvent en faveur du moindre effort. Aujourd’hui, l’I.A., ça reste des mathématiques, des bases de données comparatives. Nous en voyons déjà les limites avec des I.A. destinées à des fonctions extrêmement précises.
Comment voyez-vous le rôle de la CST face à toutes ces évolutions technologiques ?
A. L. : Nous devons être présents partout et tout le temps. Dès qu’il y a un évènement, la CST doit être là ! Je reviens du festival de La Rochelle et je pense que la CST doit y être présente dès la prochaine édition, c’est un festival important. Il faut qu’on se fasse inviter par les syndicats des exploitants lors des assemblées générales. Il faut resserrer des liens pour être présent partout. Je trouve ça très bien que la CST ait son stand au Paris Images.
[A ce stade de l’interview, Angelo et André reprennent la main pour s’interroger mutuellement sur leurs cinéphilies].
A. C. : André, te souviens-tu du premier film que tu as vu au cinéma ?
A. L. : Oui c’était La Grande Vadrouille de Gérard Oury en 1966. J’étais avec un oncle qui adorait le cinéma. Je ne me souviens pas bien de la salle où on est allé le voir, le Gaumont Palace, mais je me souviens très bien du film. Et toi Angelo ?
A. C. : Le premier film que j’ai vu au cinéma c’était Les 101 dalmatiens, mais je me souviens surtout du second film : Hélène de Troie de Robert Wise.
A.L. : Je me souviens que plus jeune, aller à Paris pour voir des films relevait de l’expédition car j’habitais dans le 78. Je prenais plusieurs bus pour arriver seulement au Pont de Neuilly !
A. C. : Quel est le premier film que tu as vu sans tes parents ?
A. L. : Je ne suis jamais allé au cinéma seul, j’y allais avec mon ami Jean-Pierre Gardelli. Je pense que le premier film qu’on a vu ensemble c’était La Main au collet d’Alfred Hitchcock. J’avais douze ans.
A. C. : Pour ma part, c’était La Brigade du diable (réalisé par Andrew V. McLaglen/NDR), un film de guerre qui avait eu son petit succès à l’époque. Je devais avoir douze ans. Pour la petite anecdote, l’année suivante, j’avais réussi à aller voir La Horde sauvage de Sam Peckinpah alors qu’il était interdit aux moins de dix-huit ans. Contrairement à toi André, j’allais souvent au cinéma seul.
A. C. : Quels sont tes trois films français préférés ?
A. L. : Diva de Jean-Jacques Beineix, Les Tontons flingueurs de Georges Lautner et Le Général Della Rovere de Roberto Rossellini qui est un film produit en France. Mes trois films étrangers préférés sont Dersou Ouzala d’Akira Kurosawa ainsi que Le Parrain et Apocalypse Now, tous deux réalisés par Francis Ford Coppola.
A. C. : Comme films français je dirais La Grande Illusion de Jean Renoir, Le Deuxième Souffle de Jean-Pierre Melville et Providence d’Alain Resnais. Côté films étrangers : Le Parrain, Dersou Ouzala et Contact de Robert Zemeckis.
A. C. : Quelles sont les personnalités qui t’ont inspiré ?
A. L. : Alain Neymar, le président de Mauboussin. Il m’a toujours inspiré dans sa façon de gérer ses affaires. Je citerais également Nicolas Seydoux. Je pense également à Jacques Chérèque de la CFDT. Ce n’était pas un syndicaliste comme les autres. Et toi Angelo ?
A. C. : Pierre Neurrisse, mon premier patron à Paris qui est totalement oublié aujourd’hui, Pierre Dumayet, sûrement l’homme le plus cultivé et intelligent que j’ai rencontré dans ma vie, et Jacques Perrin qu’on ne présente plus.
A. C. : A quel âge as-tu cru possible de travailler dans le secteur cinématographique ?
A. L. : En seconde, quand mon professeur de français nous emmenait une fois par mois au cinéma.
A. C. : Jeune adolescent, j’avais deux passions : le cinéma et la littérature de science-fiction. C’est en organisant les premières conventions de littérature S.F. que j’ai découvert que les écrivains avaient beaucoup de mal à en vivre. J’ai donc fait preuve de pragmatisme en m’orientant vers le cinéma. Ensuite j’ai eu beaucoup de chance et fait de belles rencontres car le chemin Province-Paris dans ce secteur n’est pas vraiment balisé…
A. C. : Quel a été ton premier job dans une salle de cinéma ?
A. L. : J’ai commencé comme bénévole dans un cinéma à Courbevoie, je faisais l’animation de la salle. A l’époque il y avait une commission cinéma qui se réunissait pour décider des films à présenter et des animations autour de ceux-ci. Puis je suis devenu projectionniste avant d’avoir mes propres salles de cinéma en tant qu’exploitant.
A. C. : Quel a été ton premier job côté fabrication d’un film ?
A. L. : C’était pour Le Grand Bleu de Luc Besson en 1988. J’ai accompagné le film au Festival de Cannes avec le directeur technique de l’époque Francis Croenne qui partait en retraite à la fin de l’année.
A. C. : Comment es-tu entré chez Gaumont ?
A. L. : Je suis resté sept ans dans le Sud-Ouest. J’ai dû retourner à Paris pour des raisons familiales. J’ai alors postulé chez Gaumont, Pathé, Para France, UGC et MK2. Nous étions en avril 1986. En rentrant dans la région de Toulouse, je pensais être embauché par UGC pour diriger les salles UGC Danton et Odéon, j’attends toujours le contrat ! En août 1986, je rentre à Gaumont pour remplacer le directeur du Gaumont Pont-de-Sèvres qui était parti en vacances. J’avais été contacté par Jean-Louis Renoux qui était à l’époque directeur de la distribution Gaumont à Bordeaux et que je connaissais. Je devais faire un remplacement de trois semaines, finalement je suis resté trente-neuf ans chez Gaumont !
A. C. : Quels sont tes trois moments professionnels préférés ?
A. L. : Il y en a eu beaucoup, mais quitte à choisir je dirais la projection du Cinquième Élément de Luc Besson au Festival de Cannes, l’organisation de la fête des cent ans de Gaumont avec notre ami Pierre-Édouard Baratange. A cette occasion, nous avions organisé une projection pour cinq mille personnes dans les entrepôts de la SNCF. C’est un évènement inoubliable. Enfin, je parlerais de la projection en plein air d’Atlantis de Luc Besson à Orange et pour lequel nous avions conçu le premier écran gonflable.
A. C. : Quel est le métier de technicien que tu aurais aimé pratiquer dans une autre vie ?
A. L. : Il y en a deux : ingénieur du son et directeur de la photographie.
A. C. : Qui est le technicien de cinéma que tu admires le plus ?
A. L. : Yves Robert.
A. C. : Et si tu devais te réincarner ?
A. L. : Je dirais… une chaise longue !
Propos recueillis par Ilan Ferry
Articles récents